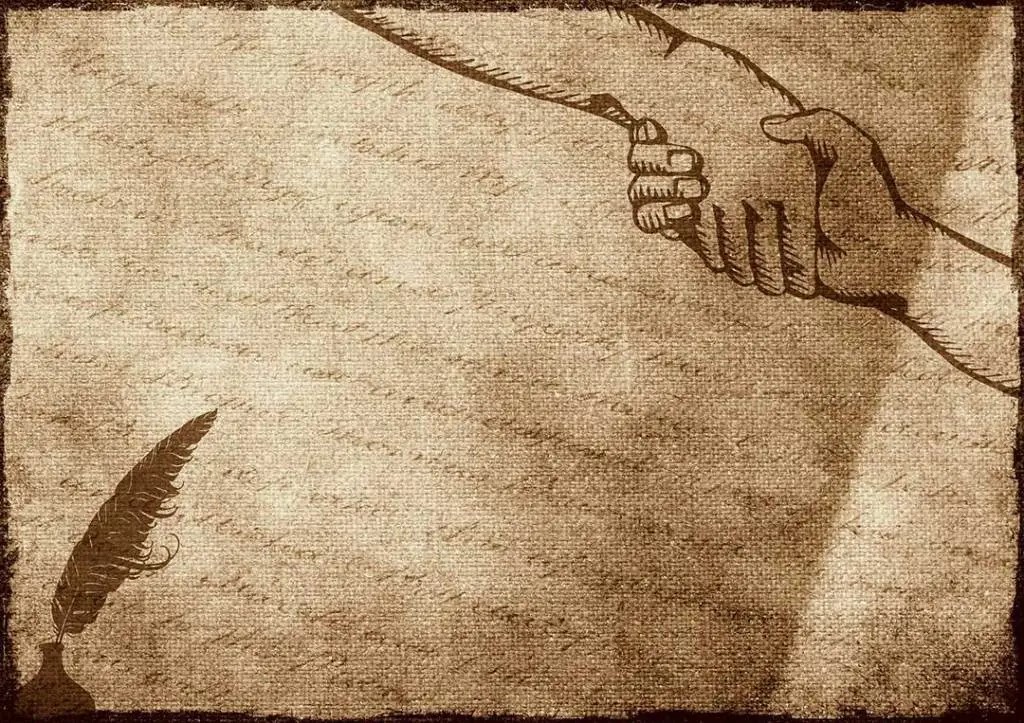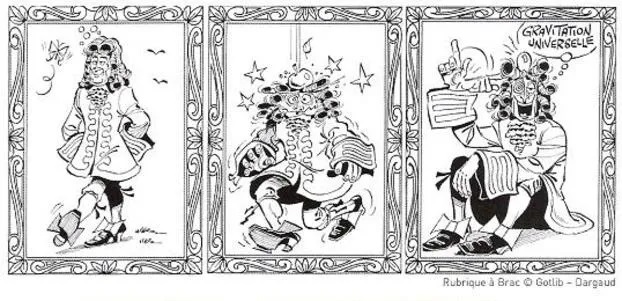Aborder sur une des îles de l’archipel wallonica.org n’est pas un hasard et, avec l’aide de la fée Sérendipité, chaque pirate y trouvera son compte. C’est là notre mission, définie dans la chasse-partie (Littré : « Accord par lequel les aventuriers règlent ce qui doit revenir à chacun pour sa part« ) que nous partageons avec nos partenaires des sept mers. A chaque île son trésor et il y en aura pour tout le monde… si chacun respecte notre chasse-partie, notre Charte de qualité.

Les pirates des savoirs ne sont néanmoins pas des corsaires, faute de subsides suffisants (à bon entendeur…). Plongez dans l’imagier de votre enfance : les corsaires étaient des pirates du Roy, financés par celui-ci et… par les trésors qu’ils capturaient ! Mais ce sont aussi des pirates, parce qu’ils écument les mers pour chasser les savoirs plutôt que de hanter des palais de marbre où ils seraient déjà « envitrinés ». Que voilà une métaphore bien filée… mais, jusque là seulement car nous ne pratiquons ni le tir au mousquet, ni la pendaison et nous ne signons pas nos articles avec notre sang, malgré notre engagement. Les temps ont changé et les sept bibliothèques de wallonica (encyclo | biblioteca | boutique | documenta | poetica | technica | topoguide) se positionnent dans un monde connecté où la technologie doit servir la liberté de pensée.
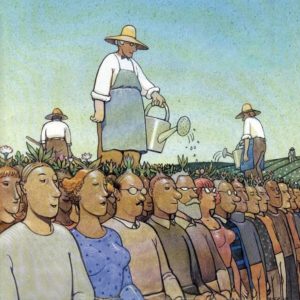
Qui plus est, notre approche encyclopédique ne vise pas à développer un site de référence supplémentaire : d’autres, dont c’est le métier, le font mieux que nous. Aujourd’hui, les musées, les universités, les institutions « à contenus », les entreprises qui gèrent leur « capital savoir » (Knowledge Assets), tout comme une myriade d’amateurs éclairés, en Wallonie-Bruxelles comme dans le reste de la Francophonie, tous ont déjà fait un travail formidable, matérialisé dans des sites et des portails fiables, richement documentés et équipés de bons dispositifs d’indexation et de recherche. Hélas, comme Baudelaire l’évoquait déjà…
J’ai longtemps habité sous de vastes portiques
Que les soleils marins teignaient de mille feux
Et que leurs grands piliers, droits et majestueux,
Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques.
La vie antérieure (in Les Fleurs du mal)
…beaucoup de ces portails s’assimilent de facto à des grottes basaltiques, où souffle le vent de la science mais où, souvent, résonnent trop peu les clics des visiteurs curieux. Monsieur-et-Madame-tout-le-monde ont le clic paresseux, quand il s’agit de culture et de citoyenneté. Faut-il accuser l’outil ?
Non. Nos fidèles le savent : de Prométhée à Icare, en passant par Adam, nos mythes fondateurs nous avertissent que l’outil n’est pas tout, qu’il n’est ni une fin, ni un dispositif suffisant. Ah ! L’illusion que l’on peut voler plus haut, toujours plus haut, grâce à des ailes artificielles. Non, plus simplement – et le message des dieux est clair – pour devenir plus humain et bien s’entendre avec soi-même – il n’est qu’un chemin : la sueur de notre front, le travail, le chemin. Dans notre cas : le travail sur les savoirs. Et la lecture… lente.
Comment dès lors susciter ce travail d’expérimentation des savoirs, d’appropriation active de notre culture de Belgique francophone ? C’est là l’objet de notre travail d’éditeur : générer une ‘expérience utilisateur’ qui débouche sur la curiosité, le débat et la digne humanité de chacun. C’est donc une question de « comment » (éducation permanente). Et nous laissons le « quoi » à nos confrères bailleurs de contenus… en partie seulement, car wallonica.org regorge également de contenus originaux.

Baptisée entre nous la méthode des deux entonnoirs, notre méthodologie tient en trois étapes principales :
-
-
- LA CAPTURE. Ici, notre technique de capture des visiteurs est aussi retorse ou perverse que celle de n’importe quel acteur du e-Business, mais c’est pour la bonne cause : nous ne vendons rien. Nous mettons en oeuvre les dispositifs techniques et sociaux qui renvoient à une expérience utilisateur familière pour nos cibles : réseaux sociaux, illustrations parlantes, navigation riche, infolettres et excellente indexation sur les moteurs de recherche… C’est notre premier entonnoir qui ratisse large pour amener le futur afficionado à un premier clic pour entrer dans l’expérience wallonica et susciter le clic suivant, celui du curieux des savoirs. Les témoignages de notre Livre d’or sont éloquents à ce propos.
- L’ANIMATION. Après le marketing pur et dur, vient le travail d’édition et d’animation. De la veille à la publication, en passant par la sélection et la réseaugraphie, chaque détail des articles (métadonnées, texte, iconographie, mise en page, liens, fiche-qualité…) doit activer la curiosité du visiteur et l’équiper pour le débat ou la réflexion personnelle. « Il faut manger le monde » disait Nietzsche. A nous de faire mâcher les savoirs pour que le « citoyen visiteur » (diraient les révolutionnaires), s’approprie ce qu’il/elle a découvert au fil des clics. Sérendipité fait loi ! C’est le canal plus concentré qui raccorde entre eux les deux entonnoirs : le passage de toutes les turbulences cognitives.
- LA REDISTRIBUTION. Si wallonica.org ne se positionne pas a priori comme un site de référence, nous avons la prétention de travailler tous les jours à redistribuer la navigation de nos visiteurs vers nos collègues de Wallonie et de Bruxelles, spécialistes ou bon vulgarisateurs. Nous sélectionnons des sujets d’intérêt issus de toute la Francophonie (notre Revue de presse ratisse large) et chaque article est assorti d’une série de onze liens vers des sites Wallonie-Bruxelles liés au même sujet ! C’est ainsi qu’un visiteur aura lu un de nos articles sur Léonard de Vinci, trouvé via un moteur de recherche, pour découvrir, au clic suivant, des artistes de chez nous, comme Brigitte Corbisier, Bénédicte Wesel ou Raoul Ubac. C’est là notre second entonnoir.
-
Voilà pourquoi wallonica.org ! Alors : « Pirates des savoirs de tous les pays, unissez-vous ! » Et si la démarche vous intéresse, contactez-nous…
[INFOS QUALITE] statut : migré et mis-à-jour (20251005) | mode d’édition : rédaction, édition et iconographie | auteur : Patrick Thonart | crédits illustrations : © DP ; © blog.action-sejours.com ; © 92 Express.